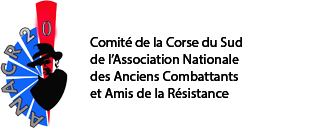Le Général Bonaparte est un des bateaux de la Compagnie Fraissinet qui assurait les rotations Corse-continent devenues rares pendant la guerre. Le soir du 18 mai 1943, il quitte le port d’Ajaccio pour Nice avec à son bord 68 hommes d’équipage et 199 passagers, parmi lesquels de nombreux enfants d’une colonie de vacances ainsi qu’une garde armée italienne chargée de surveiller la bonne destination du navire afin qu’il ne passe pas aux mains des Alliés. Cette garde italienne n’est pas du goût de Londres qui a fait savoir au gouvernement de Vichy que de ce fait ces navires étaient considérés comme ennemis.
Le Général Bonaparte est un des bateaux de la Compagnie Fraissinet qui assurait les rotations Corse-continent devenues rares pendant la guerre. Le soir du 18 mai 1943, il quitte le port d’Ajaccio pour Nice avec à son bord 68 hommes d’équipage et 199 passagers, parmi lesquels de nombreux enfants d’une colonie de vacances ainsi qu’une garde armée italienne chargée de surveiller la bonne destination du navire afin qu’il ne passe pas aux mains des Alliés. Cette garde italienne n’est pas du goût de Londres qui a fait savoir au gouvernement de Vichy que de ce fait ces navires étaient considérés comme ennemis.
Pour une meilleure sécurité, le bateau ne navigue pas la nuit. Peu après avoir quitté Ajaccio il jette l’ancre au large des Iles sanguinaires. Il ne repartira que le lendemain 19 mai au lever du jour. N’empêche qu’à 40 miles (70 km environ) de Nice, à 14 heures 30, il est atteint par deux torpilles lancées par le sous-marin anglais Sportsman. Il coule. Deux torpilleurs français, la Pomone et l’Iphigénie, saisis par la marine allemande, se portent au secours des naufragés. 137 d’entre eux seront sauvés. Joseph Damiani et son épouse Marie Rose sont de ceux-là. Ils sont les derniers survivants à s’extraire du navire. Joseph Damiani a fait le récit du naufrage.
Joseph Damiani était enseignant. Il a publié une chronique sur la langue corse durant de longues années dans « Terre corse », le mensuel du Parti communiste en Corse.
Embarquement dans la morosité. La guerre était dans tous les esprits.
 Le 18 mai 1943, une agitation inaccoutumée régnait sur les quais d’Ajaccio. Le Général Bonaparte était amarré à quai et devait appareiller pour Nice. Depuis plusieurs mois aucun bateau n’était parti d’Ajaccio pour le continent. La nouvelle faisait aller les gens sur le port. Ils arrivaient par petit groupe et se rassemblaient devant l’embarcadère. Ceux qui venaient dire adieu aux partants. Ceux qui prolongeaient la promenade jusque sur les quais. Tous ceux que le spectacle du départ d’un bateau attirait sur les lieux. Les passagers se groupaient devant le hangar de la Douane. Beaucoup s’asseyaient sur leurs bagages, dans l’attente de l’embarquement. D’autres allaient et venaient à la rencontre de connaissances. Au fur et à mesure que le départ approchait, la foule devenait bruyante. Des voix s’exclamaient, s’appelaient. Les enfants ceinturés dans leurs poussettes piaillaient. D’autres à peine plus âgés, s’accrochaient aux jupes de leurs mères et pleuraient. Des portefaix criaient de leur faire place – ils portaient sur les épaules des valises couplées à l’aide de morceaux de corde. Les gros bagages étaient tirés dans des charrettes à bras qui cahotaient avec un bruit d’airain sur les pierres mal jointes du quai.
Le 18 mai 1943, une agitation inaccoutumée régnait sur les quais d’Ajaccio. Le Général Bonaparte était amarré à quai et devait appareiller pour Nice. Depuis plusieurs mois aucun bateau n’était parti d’Ajaccio pour le continent. La nouvelle faisait aller les gens sur le port. Ils arrivaient par petit groupe et se rassemblaient devant l’embarcadère. Ceux qui venaient dire adieu aux partants. Ceux qui prolongeaient la promenade jusque sur les quais. Tous ceux que le spectacle du départ d’un bateau attirait sur les lieux. Les passagers se groupaient devant le hangar de la Douane. Beaucoup s’asseyaient sur leurs bagages, dans l’attente de l’embarquement. D’autres allaient et venaient à la rencontre de connaissances. Au fur et à mesure que le départ approchait, la foule devenait bruyante. Des voix s’exclamaient, s’appelaient. Les enfants ceinturés dans leurs poussettes piaillaient. D’autres à peine plus âgés, s’accrochaient aux jupes de leurs mères et pleuraient. Des portefaix criaient de leur faire place – ils portaient sur les épaules des valises couplées à l’aide de morceaux de corde. Les gros bagages étaient tirés dans des charrettes à bras qui cahotaient avec un bruit d’airain sur les pierres mal jointes du quai.
La sirène retentit annonçant l’imminence du départ. Les conversations amorcées se turent. Un mouvement général se fit parmi les passagers. On se mettait debout, en rang, puis on suivait en file comme des pénitents jusqu’à la visite de la Douane. Des soldats armés escortaient trois ou quatre personnes jusqu’au bas de l’échelle et les remettaient aux gendarmes chargés de les convoyer jusqu’au camp d’internement de Sisteron1Un de ces six prisonniers est Mr Canale de Sari d’ Orcino. Menotté, il parvient à sauver (entre autres ?) une des filles du préfet Balley. Cet acte de bravoure lui vaudra d’être gracié. Son petit-fils, Mr Daniel Canale a retrouvé cet article de presse qu’il nous a transmis et que nous publions. Des policiers en civil épiaient les passagers solitaires et contrôlaient leur identité. Un canon de 75 était mis en batterie sur le plateau à l’avant du navire.
Des femmes chuchotaient. Le « Cap Corse », lors de son dernier voyage, avait été atteint près de l’étrave par une torpille qui heureusement n’avait pas éclaté. L’embarquement se faisait dans la morosité. La guerre était dans tous les esprits. Les passagers étaient accueillis à bord par les employés de service qui leur donnaient les indications à suivre pour trouver leurs places, ou bien les accompagnaient. Des enfants apeurés par l’agitation bruyante qui régnait dans le bateau, se collaient aux pieds des parents. Quelques uns étaient nés en Corse. Ils avaient trois ou quatre ans.
Les manœuvres commencèrent pour se dégager des quais.
L’échelle était levée. Les amarres larguées. Le mouvement des machines s’intensifiait. Le bateau quittait le port. Sur les quais, les gens se dispersaient. Quelques-uns suivaient encore le bateau et agitaient des mouchoirs en éventails. Le soit tombait. Le soleil couchant bariolait la surface immobile de la mer d’innombrables reflets. La terre se retirait. La citadelle lentement virait de bord. Tout de suite après, s’ouvrait le golfe.
Pour éviter une méprise, la nuit à l’arrêt, tous feux éteints.
L’évènement se produisit après le passage des sanguinaires. Le commandant (NDLR : Quéré) annonça une communication. Par ordre du Haut Comité de la Marine, le Général Bonaparte devait naviguer en plein jour, pour éviter toute méprise. En conséquence, il décidait d’arrêter le bateau jusqu’au lever du jour. La nouvelle agita fort les passagers, d’autant que, au lieu de rassurer, elle faisait naître des inquiétudes. On entendit les ordres, le roulement de la chaîne d’ancre, puis le bateau s’immobilisa tous feux éteints. La nuit montait, solitaire, et voilait à peine le bateau, tant ses ombres étaient transparentes. La première clarté du matin était une ligne brillante qui se détachait au ras de l’horizon, coupant l’uniformité de la mer, du ciel encore étoilé. On aurait dit que cette ligne éphémère était faite de cendre de lune. Puis l’horizon se colorait, s’élargissait en nuances orange et mauve, avant de s’empourprer. Une brise fraîche s’était levée et faisait plisser la surface de l’eau.
Sur le bateau, le branle-bas du matin avait commencé. L’équipage était entré en mouvement. Les hommes couraient aux manœuvres. Les machines, mises en marche, faisaient entendre des ronrons monotones et cette litanie se propageait jusqu’aux étages supérieurs. Par les hublots on apercevait l’horizon qui défilait. Le bateau, progressivement prenait le large. On s’appelait. On se disait la nouvelle. Les employés de bord saluaient les gens au passage et souriaient aux enfants. L’odeur chaude du café qui s’échappait des cuisines gagnait les ponts, entrait dans les cabines, portant l’optimisme dans les cœurs. L’arrivée à Nice était prévue vers 18 heures.
Comme une montagne surgie des profondeurs de la mer
14 heures. Salon des secondes classes. La plupart des gens avaient rejoint les cabines pour se reposer. Il restait une vingtaine de personnes qui s’attardaient au repas. Un homme arrachait d’un accordéon chromatique, qu’il tenait en bandoulière, une vieille mazurka. Quelques couples dansaient. L’accordéoniste rythmait sa musique en tapant des coudes sur sa poitrine et mimait les mouvements du corps des danseurs. Il était amputé d’une jambe. Au-dessus du salon des secondes classes il y avait le pont des troisièmes classes et, à l’étage supérieur, les premières. Des enfants qui n’avaient pas suivi leurs parents dans les cabines, jouaient à cache-cache dans les entreponts. L’écho de leurs cris mêlés de rires parvenait jusque dans le salon des secondes classes. Tout à coup, le bateau s’arrêta net. C’était comme s’il avait heurté un obstacle colossal, une montagne surgie soudainement des profondeurs de la mer.
- les lumières s’éteignirent
- les tables, les fauteuils étaient arrachés de leurs attaches et projetés en morceaux épars
- tout ce qui était boiserie s’était désintégré en une multitude d’éclats de bois
- l’escalier de fer, qui donnait accès sur le pont au-dessus du salon s’était écroulé
- Les gens étaient enlevés et projetés en l’air ou contre les parois de la coque dénudée.
- des corps étaient étendus sur le sol. Ils ne bougeaient pas. Il y avait des blessés. Certains saignaient du nez ou des oreilles. D’autres étaient comme paralysés. Des infiltrations d’eau apparaissaient le long de la coque. Une fumée de poudre brûlée se répandait partout. Il n’y avait pas de cris, mais de la stupeur, des égarements sur les visages. On était torpillé. Le bateau allait couler. Les regards allaient de l’un à l’autre. La fraction de seconde était une éternité de temps. Un moment d’espoir : la mer se montrait par les hublots. On se précipitait. Le hublot s’ouvrait en demi-lune. On tournait en rond.
Sauve qui peut !
Un trou dans le plafond, par lequel on pouvait voir le jour, était le miracle. L’explosion avait soufflé un treuil qui laissait un trou béant. Au-dessous, les débris de bois, de métal, s’étaient entassés et formaient un monticule. En montant dessus on arrivait à poser les mains sur les bords du trou et à gagner le pont. On se précipita vers ce secours inespéré.
Une jeune femme mettait tous ses efforts à se hisser. Du sang coulait de son visage. Son compagnon la tenait enserré dans ses bras et la poussait. Plus tard, elle raconta que le pont était désert. L’arrière du bateau était enfoncé dans l’eau qui venait de s’étaler sur le pont, et pêle-mêle des morceaux de mât, des planches, des débris de toues sorte, des cadavres, flottaient à la dérive. Elle ne savait pas nager. Elle attrapa une planche et s’assit dessus, puis elle s’éloigna du bateau en ramant avec les mains.
Un craquement prolongé fit vaciller le bateau. Des cloisons s’écroulaient, des poutres tombaient lourdement et s’immobilisaient en se croisant. Le bateau avait des soubresauts. L’eau montait et faisait un lac sur le plan incliné. La peur saisissait les cœurs. On se bousculait. Les plus forts repoussaient les faibles. On se précipitait pour atteindre les premiers la brèche qui donnait accès sur le pont. On s’engouffrait dedans. Qui jetait un bras, qui avançait la tête, qui glissait une épaule. La confusion grandissait. Ceux qui se trouvaient derrière s’agrippaient à ceux qui étaient devant. On ne pouvait plus avancer ni reculer. Ils coulèrent avec le bateau. Debout, adossé à la coque un prêtre lisait un bréviaire. Il était breton. Dans un coin, à demi couchée, une jeune fille agonisait, la poitrine défoncée par un éclat de table. C’était un professeur. Elle avait obtenu sa mutation sur le Continent.
Les cloisons qui limitaient les secondes classes étant tombées, on pouvait voir dans le ventre du bateau. La salle des machines était un amas de fers tordus qui s’enchevêtraient dans des tôles et des poutres fumantes. La torpille avait fait des brèches sur le flanc de la coque, en plusieurs endroits. Le compagnon de la jeune femme s’engouffra dans une de ces brèches et réussit à sortir du bateau.
Des hurlements qui n’avaient plus rien d’humain
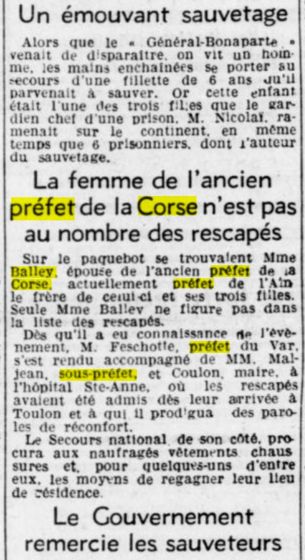
J’arrête provisoirement mon récit aux évènements tragiques qui se sont déroulés le 19 mai 1943 dans les secondes classes du Général Bonaparte. Après ce jeune homme, plus personne n’était sorti vivant du salon. Le récit qui va suivre m’a été fait par un passager échappé du naufrage. Il relate ce qui s’est passé dans les étages supérieurs du bateau et ce qui s’en est suivi. Je reviendrai au naufrage, après que mon interlocuteur aura terminé son récit.
« J’ai vécu, monsieur, deux minutes qui m’ont paru une éternité. Sous le choc le mât avant se rompait et s’abattait, entraînant dans sa chute un amas confus de câbles, de cordages, d’anneaux, blessant des hommes de manœuvre qui prenaient du repos dans la hune du pont. Le bateau n’avait plus de gouvernail. L’eau entrait en tourbillonnant par un trou béant fait à la coque, inondant la chambre des machines. Aux étages supérieurs, il était impossible de n’y rien reconnaître. On aurait dit qu’un ouragan avait passé là. Les portes des cabines étaient bloquées par les éboulements. Le pont promenade dénudé – des planches arrachées du parquet – les bastingages n’étaient que débris.
Voyez-vous, le plus terrible, n’était pas le spectacle de ces ruines, la destruction du bateau, mais la vision obsédante des scènes folles qui ont eu lieu. Des cabines emmurées par les éboulements, montaient des cris, des appels au secours, coupés par des hurlements qui n’avaient plus rien d’humain. Sur le pont et dans les couloirs, des gens couraient avec des gestes désordonnés. Certains prenaient une piste puis l’abandonnaient pour en prendre une autre qui n’était pas meilleure. Il y en avait qui croyaient voir une ombre, entendre une voix, là où il n’y avait rien. Mais le pire, monsieur, s’est passé sur les canots de sauvetage. C’était la cohue. La peur égarait les esprits. Hommes, femmes, enfants, se ruaient à la curée des places, avant même que les canots fussent à la mer. On se poussait, on se jetait les uns sur les autres. Les embarcations tanguaient au bout de leurs amarres. A un moment, une forte secousse du bateau les fit basculer, et beaucoup de personnes passèrent par-dessus bord. La plupart se noyèrent. Voyez-vous, monsieur, même en ce moment où je vous raconte ces choses qui se sont passées, il me vient des angoisses dans le cœur ».
Le bateau s’enfonça dans la mer, presque à la verticale.
Le soleil avait parcouru un peu plus de la moitié de son chemin et sa lumière, légèrement irisée, faisait des joyaux dans la mer. Des fumées d’opaline passaient dans le ciel bleu, à peine perceptible, semblables à des plumes de cygnes. La brise, furtive comme un souffle, avait l’odeur du large.
L’arrière du bateau s’enfonçait, tandis que la partie avant se soulevait et se dressait hors de l’eau. Un homme se tenait debout, adossé au canon de 75, et faisait de grands gestes avec la main. On aurait dit un apôtre grondant l’anathème. Des soubresauts firent trembler toute la masse du bateau. Il résista une fraction de seconde, puis d’un coup, il s’enfonça dans la mer presque à la verticale, comme si une force fabuleuse lui avait entrouvert les eaux. Un bouillonnement d’écume monta et se répandit à la surface.
Les passagers qui avaient pu s’échapper du bateau flottaient éparpillés au milieu de toutes sortes d’épaves auxquelles ils s’accrochaient. Pêle-mêle, circulaient des planches, des troncs de billots, des carcasses, des valises, des malles. Parmi ces objets, des voitures d’enfants faisaient le va et vient, sans s’éloigner, légères, peintes de couleurs vives. Elles avaient des mouvements de berceaux. Des cadavres passaient par intervalles, semblables à des mannequins, gonflés par l’eau, la bouche béante, et leur image ondulait dans l’eau. On ne les regardait pas, de crainte de reconnaître quelqu’un des siens. Une fillette de 12 ans se tenait assise sur une planche, le regard immobile, une immobilité que seuls les animaux sont capables de garder. Elle avait perdu son père, sa mère et son jeune frère dans l’explosion. Émergeant au-dessus de l’horizon, deux avions se dirigeaient vers le lieu du sinistre. Ils planèrent un moment au-dessus des naufragés, puis ils se mirent à tourner en rond, à la manière des chevaux de manège. Des naufragés lancèrent quelques appels de la main. Les deux avions continuèrent leur manœuvres une dizaine de minutes, puis virèrent de bord et disparurent.
Deux torpilleurs pour amener les rescapés à Toulon
Il était environ 4 heures de l’après-midi. Deux torpilleurs pareils à une traînée sombre apparaissaient au large. Ils naviguaient sous couleurs allemandes. Quand ils furent à une distance où l’on voyait les naufragés, ils stoppèrent et mirent les canots à la mer. Les survivants qui s’étaient rassemblés en petit groupe sur des radeaux de fortune et sur deux embarcations qui avaient échappé au naufrage prenaient place sur les banquettes latérales des canots. On se serrait sans rien se dire. Les cadavres des victimes qui avaient surnagé étaient couchés à fond de cale, puis recouverts d’une large couverture militaire. Les trépidations des moteurs les faisaient bouger bizarrement. On aurait dit qu’ils se mettaient à revivre. Quand les recherches furent abandonnées, les canots regagnèrent leurs bâtiments qui mirent le cap sur Toulon.
Le soleil déclinait. C’est le moment instable où les couleurs changent, passent du clair au foncé. L’air fraîchissait. Au-dessus de l’horizon, quelques nuages dilatés, s’éparpillaient en laissant filtrer les derniers rayons du soleil couchant. Les deux navires roulaient, impassibles, laissant traîner derrière eux une queue d’écume argentée qui tranchait sur le grand bleu de la mer. Par intervalles, des vols bas de goélands passaient au-dessus des navires en tournoyant, puis repartaient en poussant des cris stridents. On s’approchait de Toulon.
Les torpilleurs se montrèrent au port par eau calme. Ils avançaient bord à bord, comme deux ombres. La vue du port redonnait espoirs aux rescapés de retrouver un parent, un ami, un membre de la famille, lorsque tous les passagers seraient débarqués. Aux abords du port, des attroupements s’étaient formés. Des agents du service d’ordre s’efforçaient de contenir les gens éloignés des quais, pour qu’ils ne gênent pas les opérations d’accueil. Mais la foule qui continuait d’affluer résistait, poussait devant elle. Il y avait des marins, des douaniers, des policiers, des agents de la défense passive qui circulaient sans arrêts, dans l’encombrement des ambulances, des voitures, et toutes espèces de machines déposées à quai. La lumières camouflée des lampes donnait à l’endroit un aspect lugubre.
Lentement, les bateaux se placèrent le long du quai, à quelques mètres l’un de l’autre, les rescapés se pressaient, silencieux, sur le pont qui faisait face au quai. Des matelots avaient dégagé l’échelle principale, véritable escalier mobile avec des paliers en fer. La descente commença. Les rescapés étaient guidés par des hommes jusqu’à terre, où ils étaient pris en charge par les organisations de secours.
Disparus ? Morts ? Survivants ? L’ultime confrontation avec la réalité
C’était l’ultime confrontation avec la réalité. Le drame éclata. Les gens s’élançaient dans toutes les directions, comme mus par une machine, à la recherche de celui qui manquait. On courait. On se précipitait à la rencontre les uns des autres. On s’embrassait. On croyait reconnaître un être cher, ce n’était pas lui. Un visage, c’était celui de quelqu’un d’autre. Des voix criaient des noms comme on crie au secours, lorsqu’il n’y a plus d’espoir. A l’écart, des couples qui s’étaient retrouvés cachaient leur joie dans de longs embrassements silencieux.
La foule s’ouvrait sur le passage des convois de rescapés que l’on conduisait à l’hôpital Sainte-Anne. Dans la nuit, sous les lumières masquées des lampadaires, la file des voitures figurait un défilé de corbillards. Dans la foule émue, agitée, des voix s’élevaient. A bas la guerre ! La route de l’hôpital montait, en faisant des détours, et les phares des voitures marquaient la nuit de leurs lueurs clignotantes. Les signaux sonores des sirènes, le ronflement des moteurs devenaient lointains. Au bout d’un moment ce n’était plus qu’une rumeur qui finissait de s’achever. Le silence pesait sur le port.
Les rescapés étaient passés.
Joseph Damiani
ADDENDUM. Courrier reçu de Mme Sylvie Martin-Royan.
« Mon grand père, Joseph Martin, vivant à Marseille était un mécanicien de la Cie Fraissinet et sur ce bateau ce jour là. Il venait de finir son quart « aux machines » comme il disait, et était en train de se doucher quand le bateau a reçu la ou les torpilles. Il est sorti tout nu des douches et dans l’affolement général a saisi deux gamines qui hurlaient de peur, chacune sous un bras, et a il sauté dans l’eau. Il s’en est sorti, elles aussi. Il n’en a jamais parlé, c’est par mon père que je l’ai appris. Mon père à 17 ans est entré au « maquis » peu de temps après. Mon grand père faisait régulièrement la liaison Corse et a eu du mal a accepter que tant d’innocents meurent et de plus, par un sous marin britannique. Tous ses amis sont morts dans les machines et tant de civils aussi. […] »
Mme Sylvie Martin-Royan. Courriel reçu le 20.08.2023