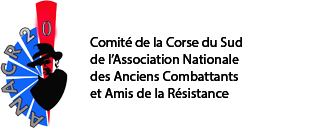Le 19 septembre 2019, le Parlement européen a adopté une résolution sur « l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe ». Ce faisant, elle mettait en pratique un des objectifs majeurs de l’Histoire : étudier le passé, afin de comprendre le présent et préparer l’avenir. Démarche louable s’il en est, humaniste et unificatrice au plan générationnel, voire civilisationnel. Dans cette optique, cette résolution, à travers les principes universels des droits de l’homme et ceux fondamentaux de l’Union européenne, dénonçait les crimes et pratiques des régimes totalitaires en Europe, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Deux systèmes étaient, de ce point de vue, mis en évidence et concomitance : le soviétisme stalinien et le nazisme, à travers leurs représentations étatiques respectives (Allemagne nazie et URSS).
Parmi les arguments justifiant la résolution, celui du Pacte germano-soviétique du 23 août 1939 (points B et C, p. 2) était mis en avant comme déclencheur direct de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, l’Union soviétique, au même titre que l’Allemagne nazie, était responsable d’un conflit ayant fait près de 68 millions de morts… De nos jours, cette vision réductrice se heurte à deux réalités, propres au renouvellement du champ de la science historique : l’analyse des nouveaux fonds d’archives soviétiques – après 1991 – et la publication d’ouvrages – à partir de ces mêmes fonds d’archives, voire de témoignages d’acteurs de la période – jetant un autre regard sur la période 1933-1939, à travers les relations anglo-franco-germano-soviétiques. De ce point de vue, six études sont particulièrement significatives de ce renversement de perspective, montrant, de manière très documentée, que les véritables responsabilités ne sont pas forcément celles admises par la doxa du Parlement européen.
I. Les « invariants » géostratégiques de l’histoire de la Russie
Du Moyen-Âge au XIXe siècle, la Russie a subi les assauts d’envahisseurs venus de l’ouest : Chevaliers teutoniques, Suédois (Charles XII), Français (Napoléon). Au début du XXe siècle, au lendemain de la Révolution d’Octobre, le gouvernement bolchevik s’est trouvé confronté à une coalition impliquant quatorze pays, à l’ouest, au nord, au sud et à l’est du territoire soviétique. L’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933, va conforter et renforcer la vieille tendance géopolitique du Drang nach osten (marche vers l’Est), qui, depuis l’époque médiévale, détermine la politique étrangère allemande, toujours tournée vers l’Est (Ostpolitik). Cette constante géostratégique a obligé la Russie à ériger des États tampons entre ses frontières et celles de l’Allemagne, déterminant ainsi sa politique étrangère et sa stratégie militaire, principalement défensives.
II. Volonté soviétique et démissions occidentales à la veille de la Seconde Guerre mondiale
Dans son ouvrage La guerre à l’Est, Boris Laurent souligne la volonté de Staline de créer un front commun face à la politique agressive hitlérienne : « À l’Est, Staline constate amèrement le manque d’ardeur du duo franco-britannique face aux prétentions hitlériennes. Pourtant, son commissaire politique aux Affaires étrangères, Maksim Litvinov, ne ménage pas ses efforts pour établir une sécurité collective et créer un axe Londres-Paris-Moscou contre Hitler ». Cependant, comme le rappelle l’auteur, « Malgré sa bonne volonté et un projet de front commun antihitlérien, Litvinov ne parvient pourtant pas à rallier Londres et Paris enferrés dans leur anticommunisme ».
La démarche soviétique, logique dans son essence géostratégique (Staline sait que, tôt ou tard, l’Allemagne et son pays seront en guerre), se heurte à la méfiance et aux atermoiements des Franco-Britanniques, deux variables diplomatiques qui témoignent de la politique de démission de Paris et Londres à l’égard d’Hitler. Cette attitude frileuse est au cœur du dernier ouvrage sur le sujet, Apaiser Hitler, où l’auteur déroule le fil diplomatique des relations entre Berlin, Londres et Paris, de 1933 à 1939, démontrant le recul des deux démocraties occidentales devant les prétentions territoriales d’Hitler, dans un contexte de poker menteur où le pouvoir nazi impose et concrétise ses aspirations expansionnistes. Une publication antérieure, Journal 1932-1943, d’Ivan Maïski, ambassadeur d’URSS à Londres, constitue le témoignage le plus éclairant, car au jour le jour, sur les tentatives soviétiques d’une alliance de sécurité collective, Londres, Moscou, Paris, contre le danger allemand.
Litvinov et Maïski n’ont de cesse de solliciter leurs homologues Franco-Britanniques (Chamberlain, Halifax, Bonnet) en ce sens. Malheureusement, la méfiance et, surtout, l’anticommunisme des seconds rendent caduques les velléités de pacte collectif. Seul, Churchill, en Angleterre, est en phase avec l’initiative russe, comprenant que, de démission en démission, la diplomatie britannique ouvre les portes d’un futur conflit européen.
III. Le tournant tchécoslovaque (septembre 1938-mars 1939)
Depuis sa nomination au poste de Chancelier du Reich (30 janvier 1933) et de Reichführer – chef de l’État – (2 août 1934), Hitler a violé à trois reprises certaines clauses du Traité de Versailles : 1935 (rétablissement du service militaire), 1936 (remilitarisation de la Rhénanie), 1938 (annexion de l’Autriche). De plus, l’accord naval anglo-allemand de 1935 lui permet de reconstituer, de manière détournée, mais légale, la marine de guerre allemande.
En septembre 1938, l’affaire des Sudètes (région située à l’ouest de la Tchécoslovaquie et peuplée de 3,2 millions de germanophones) va de nouveau conforter le leader nazi dans son ambition territoriale (constitution d’un grand Reich allemand), mais surtout montrer l’absence de fermeté des Britanniques et des Français dans le traitement de cette crise diplomatique. La revendication hitlérienne à l’égard des Sudètes, théoriquement et pragmatiquement, correspond à deux objectifs :
— Appliquer sur le terrain, suivant les principes définis dans Mein Kampf, l’intégration au Reich des populations définies comme aryennes ;
— Annexer le riche potentiel industriel et minier des Sudètes, dans la logique du réarmement et, a fortiori, de la future économie de guerre.
Sur le plan militaire, la Tchécoslovaquie n’est pas seule, ayant deux alliés de poids : la France et l’URSS. Dans cette optique, Litvinov indique que l’URSS tiendra ses engagements vis-à-vis des Tchèques, sollicitant Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères français, pour une réunion commune d’état-major. Celui-ci ne donne aucune suite à la proposition. De son côté, Maïski essaie de prendre langue avec Halifax (secrétaire d’État aux Affaires étrangères), sur l’opportunité d’une alliance Londres-Moscou-Paris, en vue d’arrêter Hitler. Ce dernier indique qu’il ne peut le recevoir. Aussi, en dernier ressort, l’ambassadeur soviétique va trouver Churchill (conscient de l’utilité d’un front de sécurité collective contre Hitler), qu’il juge seul apte à écouter la requête de son gouvernement. Il demande à ce dernier de transmettre à Halifax une demande officielle de Moscou, ce que fait Churchill. Cependant, Chamberlain, Premier ministre britannique, entend agir seul vis-à-vis d’Hitler. Méfiant et peu enclin à une entente avec Moscou, il se rend en Allemagne, persuadé qu’il pourra infléchir la décision du Führer à l’égard de la Tchécoslovaquie. Démarche illusoire vers un homme dont le seul objectif est d’annexer, non seulement le territoire des Sudètes, mais la totalité du territoire tchécoslovaque. La suite le montrera : la démission de l’Angleterre et la France à Munich, en septembre 1938 (abandon des Sudètes) ; l’annexion pure et simple du territoire tchèque par les troupes allemandes (mars 1939).
IV. Vers le pacte germano-soviétique
Dans ce contexte de trahison de la Tchécoslovaquie par l’Angleterre et la France, les Soviétiques, non conviés à la Conférence de Munich, conscients du jeu trouble des Franco-Britanniques, notamment des seconds, lesquels entretiennent des relations secrètes avec le Reich allemand, au plan diplomatique et financier, s’orientent inévitablement vers un autre choix diplomatique. Ce choix est dicté par quatre facteurs :
– La constante historique géo-stratégique (menace venue de l’ouest) ;
– La crainte – justifiée – d’une inéluctable attaque allemande, dont il faut repousser le plus possible l’échéance ;
– L’impact terrible des purges staliniennes des années 1937-1938, qui ont décimé l’élite de l’état-major soviétique et désorganisé l’outil et la stratégie militaire russes ;
– L’inévitable isolement dans lequel va se trouver, par la force des choses, l’Union soviétique.
Aussi, comme le souligne Michael J. Carley : «Tout comme l’historien russe Roy Medvedev et le général Dimitri Volkogonov, […] l’Ouest ne laissa pas d’autre choix au gouvernement soviétique que de conclure le pacte de non-agression avec Hitler». Citant d’autres auteurs, il écrit : «Roberts et Sipols suggèrent implicitement que le pacte de non-agression était dû à l’échec des négociations franco-anglo-soviétiques – celles de la mission franco-anglaise à Moscou, en août 1939 – plutôt que le contraire». Il poursuit son raisonnement, ajoutant : «[…] l’anticommunisme entrava les efforts franco-britanniques visant à conclure avec l’URSS une alliance en cas de guerre avec l’Allemagne. Le rejet par la France et la Grande-Bretagne des nombreuses initiatives soviétiques en vue d’améliorer les relations durant l’entre-deux-guerres, ou pour créer une coalition antinazie, spécialement entre 1935 et 1938, augmenta considérablement la méfiance et le cynisme soviétiques ». En conséquence, « La réplique soviétique – le pacte de non-agression avec les Allemands – était de la mauvaise diplomatie, comme le concèdent aujourd’hui de nombreux historiens russes, mais alors, dans l’extrême tension des dernières semaines de paix, cela semblait être le seul moyen d’assurer la sécurité, au moins à court terme, de l’URSS ».
En définitive, c’est par pur pragmatisme, dans l’optique de préserver ses intérêts propres, durant un laps de temps qu’elle sait court, que l’URSS s’oriente vers un rapprochement avec l’Allemagne nazie, ne voulant pas, selon la formule de Staline, « tirer les marrons du feu ». Cette attitude prudente va conduire le maître du Kremlin à une politique passive, voire craintive à l’égard d’Hitler, au lendemain de la signature du pacte du 23 août 1939, évitant d’irriter celui-ci et respectant à la lettre les clauses du traité, notamment sur le plan économique (les livraisons de matières premières continuaient le jour du déclenchement de l’opération Barbarossa, le 22 juin 1941).
En signant un pacte avec Staline, Hitler n’avait d’autre objectif que de se préserver stratégiquement à l’Est, en neutralisant toute possibilité d’apport militaire soviétique au profit des Franco-Britanniques, dont il doutait, à tort, qu’ils n’interviendraient pas dans la future opération polonaise. Son « Nous avons gagné !», au lendemain de la signature du pacte, est significatif de sa véritable arrière-pensée, au plan géo-stratégique européen. Comme l’a écrit Gabriel Gorodetsky, l’accord Hitler-Staline fut un grand jeu de dupes, basé sur deux stratégies diamétralement opposées : l’une, offensive, du côté allemand (les faits le démontreront) ; l’autre défensive, du côté soviétique (malgré les clauses du protocole secret vis-à-vis de la Pologne). Ce même Gorodetsky précise : « Les garanties unilatérales britanniques données à la Pologne le 31 mars 1939 – au lendemain de l’annexion de la Tchécoslovaquie par Hitler – constituent le pas décisif vers le pacte Ribbentrop-Molotov et les premières salves de la Seconde Guerre mondiale». Il ajoute, soulignant de nouveau la responsabilité britannique dans l’orientation conjoncturelle de la diplomatie soviétique : « Le jour même de la signature du pacte, sir Neville Henderson, l’ambassadeur britannique à Berlin, reconnaissait que la politique britannique à l’égard de la Pologne l’avait finalement rendu inévitable».
V. Histoire et neutralité mémorielle
Le renouvellement de l’historiographie concernant les origines de la Seconde Guerre mondiale et, de manière plus précise, le conflit germano-soviétique, à l’aune des nouvelles archives – soviétiques notamment -, oblige à une relecture critique de la trame diplomatique balisant les relations entre l’URSS, l’Allemagne, l’Angleterre et la France, dans la seconde moitié des années trente. Les différentes études, auxquelles nous avons fait référence plus haut, témoignent, de manière claire, que, dans le déclenchement du Second Conflit mondial, Britanniques (Chamberlain) et Français (Bonnet, Daladier), portent la responsabilité première. Leur anticommunisme viscéral, induisant une méfiance récurrente à l’égard de l’URSS, complété par une attitude de démission – Appeasement – à l’égard d’Hitler, ont fait obstacle à la volonté soviétique d’une politique de sécurité collective (le Journal d’Ivan Maïski est édifiant à cet égard). De ce point de vue, on peut considérer la résolution du Parlement européen comme reposant sur une base scientifique peu crédible, davantage marquée du sceau idéologique que véritablement historique. Aussi, rendre l’URSS stalinienne coresponsable avec l’Allemagne nazie, par le biais d’un pacte imposé par les circonstances, du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, c’est s’inscrire, faisant fi des récentes sources documentaires exhumées, dans un processus de cécité historique, qui bafoue, in fine, notre mémoire collective européenne.
Hubert Lenziani
Sur le même sujet : Retour sur une déclaration révisionniste du Parlement européen