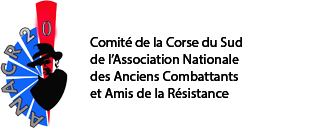Ian Kershaw, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Sheffield, l’auteur entre autres d’une monumentale biographie d’Hitler (Flammarion 1999-2000) qui a fait date, nous livre cette année un ouvrage tout aussi remarquable : « Choix fatidiques, dix décisions qui ont changé le monde. 1940-1941 » (Seuil 2010). Il y analyse les choix stratégiques faits au début de la guerre par les protagonistes : Allemagne, Italie, Japon, Grande-Bretagne, U.S.A et U.R.S.S. En fait, seulement les pays qui n’étaient pas occupés et dont les gouvernements avaient en ces années 40-41, la maîtrise des choix stratégiques pour leur armée. La France n’en fait pas partie mais son sort leur étant lié, la lecture de ce livre est instructive pour nous et plus particulièrement, pour la Corse, les choix faits par l’Italie en cette année 1940.
Mussolini veut participer à la curée
 Eté 1940 : l’armée française en déroute avec près de 100.000 morts et 1 800.000 prisonniers, 3/5ème de la France occupés par la Wehrmacht, des millions de gens jetés sur les routes pour rejoindre le sud ; bref, la débâcle. Un gouvernement de circonstance réfugié à Vichy accepte la défaite et met à profit la présence de l’occupant pour assouvir sa soif de vengeance contre le Front populaire et en finir avec les acquis de la Révolution française : « 150 années d’erreur » selon les termes du Maréchal Pétain, lors du 150ème anniversaire de la Révolution en 1939.
Eté 1940 : l’armée française en déroute avec près de 100.000 morts et 1 800.000 prisonniers, 3/5ème de la France occupés par la Wehrmacht, des millions de gens jetés sur les routes pour rejoindre le sud ; bref, la débâcle. Un gouvernement de circonstance réfugié à Vichy accepte la défaite et met à profit la présence de l’occupant pour assouvir sa soif de vengeance contre le Front populaire et en finir avec les acquis de la Révolution française : « 150 années d’erreur » selon les termes du Maréchal Pétain, lors du 150ème anniversaire de la Révolution en 1939.
Et voilà que Mussolini se met de la partie et déclare la guerre à la France et à l’Angleterre le 10 juin 1940. Il n’a même pas pris la peine de consulter le Grand Conseil fasciste. Ciano, son gendre et ministre des affaires étrangères, essaye, dit-il, de le dissuader parce que « …ce sera la ruine du pays, la ruine du fascisme et la ruine du Duce lui-même ». (p. 223). Prophétique. Badoglio, c’est du moins ce qu’il assure, s’y oppose carrément (p. 235). Le roi « à qui Mussolini voue une haine tangible » (p. 232) est peu enthousiaste. Et le Duce sait « que la plus grande partie de la population (est) tiède, voire franchement hostile » (p. 230). Mais Mussolini brule d’impatience. « Il est humiliant de rester les bras croisés pendant que d’autres écrivent l’histoire, déclara-t-il à Ciano. Pour un peuple grand, il faut l’envoyer à la bataille, même s’il faut lui botter le train » et au passage il insulte le peuple italien qui se conduit « comme une putain…toujours du côté du gagnant ». (p. 229)
Pourtant, alors qu’il avait prévenu Hitler, lors de la signature du Pacte d’acier, le 22 mai 1939, que l’Italie ne serait pas prête avant 1943 (p. 209), il entre en guerre contre la France et l’Angleterre. La France, mise à terre par son allié nazi, il espère participer à la curée en annexant la Corse, Nice, la Savoie, la Tunisie et Djibouti. Durant deux semaines, avant qu’il signe l’armistice le 24 juin, il livre bataille aux frontières franco-italiennes avec de maigres conquêtes. L’aviation italienne effectue en Corse quelques raids aériens sur les côtes, visant plus particulièrement les objectifs militaires. Le bilan est peu glorieux pour le Duce. Mais ça ne suffit pas à rassurer les Corses pour l’avenir. Ils savent les prétentions de l’Italie fasciste sur l’île, « terra irredenta ». Certes, ils ne doutent pas qu’à l’exception d’une poignée de sympathisants irrédentistes, la population leur est hostile mais les patriotes peuvent-ils compter sur le gouvernement de Vichy pour leur éviter l’annexion ? Rien n’est moins sûr quand on sait la docilité de Pétain à l’égard de l’occupant nazi. Or c’est bien à Hitler, et lui seul, qu’appartient la décision.
C’est Hitler qui décide
Que veut le Führer ? L’armée française vaincue, il ne reste plus que le Royaume Uni pour lui résister en Europe. Mais encore faut-il que la France conquise ne regimbe pas. C’est pour cette raison qu’il faut laisser au gouvernement de Vichy un territoire suffisant pour qu’il puisse se prévaloir auprès des Français du bienfondé de sa politique de collaboration avec l’ennemi. Le Führer ne veut pas avoir à combattre en France, en arrière de sa ligne de front atlantique, au moment où il faut livrer bataille sur la Manche. Pas question donc de laisser Mussolini contrarier cet objectif primordial ; il devra se contenter d’annexer quelques centaines de Km2 qu’il a occupés à la frontière. Pas plus. Pas la Corse donc. Pour la conquête du Mare Nostrum, (le Lebensraum italien), Corse comprise, Mussolini doit patienter. Hitler le lui répètera encore lors de leur rencontre au col du Brenner le 4 octobre 1940, tout en renouvelant « son soutien aux prétentions territoriales de Mussolini à l’égard de la France : Nice, la Corse, Tunis et Djibouti » (p. 253)
Le Duce doit s’incliner. C’est un coup dur porté à son prestige. L’article 2 de la Convention d’armistice signée à Rome le 24 juin par le Général Huntziger et le Maréchal Badoglio stipule que « Les troupes italiennes se maintiendront (…) sur les lignes qu’elles ont atteintes sur tous les théâtres d’opération. » La Corse ne sera pas occupée en cet été 40. Elle sera cependant désarmée et placée sous contrôle d’une Délégation Italienne d’Armistice (D.I.A.) dont les vingt trois premiers membres arrivent à Ajaccio le 8 juillet. Ils ne sont pas en terrain conquis et les Corses ne tarderont pas à le faire savoir. Question de dignité. Mais leur inquiétude persiste : « resterons-nous Français ? » Et que faire pour le rester ? Faire confiance au Maréchal, courber l’échine? Liquider la République pour expier, comme il le demande ? Ou alors tenir tête au Maréchal comme le fait Paul Giacobbi à Vichy le 10 juillet ? Tenir tête à l’envahisseur en répondant à l’appel du Commandant François-Marie Pietri qui appelle depuis Vichy où il se trouve à former une « Légion corse » parce que, écrit-il, « La Corse de Sampiero, la Corse de Paoli et des Cinarchesi ne s’est donnée qu’une fois : elle s’est donnée à la France. » La flamme de la Résistance était allumée, vacillante en cet été 40. Il lui faudra de longs mois pour grandir et s’affirmer. Et beaucoup de sacrifices.
Redorer son blason en Grèce
Quant au Duce Il rumine sa rancœur contre le Führer. Privé de l’occasion de se couvrir de gloire en France, humilié par l’autorisation d’Antonescu donnée aux troupes allemandes de stationner en Roumanie et au vu du peu d’empressement du Maréchal Graziani en Afrique, il se jette à corps perdu en Grèce pensant y redorer son blason ; au grand dam d’Hitler qui pour l’heure veut le calme dans les Balkans pour ne pas avoir à détourner vers cette région des ressources qui lui seront utiles pour l’invasion de l’Union soviétique et pour la conquête de l’Egypte.
Loin d’être une promenade d’agrément, l’attaque tourne à la catastrophe parce que les Grecs opposent une résistance farouche : 150 000 victimes côté italien, 90 000 chez les Grecs. « En l’espace de six semaines, l’Italie qui aspirait à devenir une puissance mondiale s’était montrée militairement plus faible que le poids mouche grec. On n’aurait pas pu imaginer révélation plus claire du talon d’Achille de l’Axe. » (p. 263). « Pour l’Italie, la catastrophique invasion de la Grèce, avec le désastre de la flotte coulée à Tarente et l’effondrement ignominieux en Afrique du Nord, marquèrent la fin, une fois pour toutes, de ses prétentions de grande puissance. L’idée d’une guerre parallèle pour construire l’Imperium n’était qu’une chimère » (p. 269). Après l’entrée en guerre aux côtés des Allemands, l’invasion de la Grèce est le deuxième choix fatidique fait par Mussolini en cette année 40, avec l’aval de Ciano cette fois. Cet enlisement de l’armée italienne en Grèce à l’automne 40, après le refus d’Hitler de laisser Mussoloni annexer les territoires irredente n’a pas été sans conséquences pour la Corse.
Antoine POLETTI