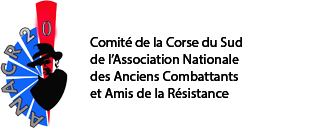Cette conférence de l’historien Francis Pomponi a été publiée par l’ANACR 2B dans une brochure intitulée « L’irrédentisme et la Corse », avec d’autres actes du VIIème colloque que l’ANACR 2B avait organisé le 27 mai 2019 à Bastia. Elle est présentée avec un sous-titre « Introduction » par l’auteur et comme une version écrite de sa conférence sans notes.
L’étymologie du terme irrédentisme n’est pas des plus parlantes, ce qui a pu parfois prêter à confusion. Le concept s’est néanmoins doté avec le temps d’une signification largement partagée aujourd’hui pour désigner le mouvement de revendication par l’Italie de terres historiquement, linguistiquement et culturellement «italiennes» qui ont été distraites de la «mère patrie», par tradition ou par voie de conquête de la part d’Etats voisins de la péninsule. Cela concerne notamment les diverses terres «italiennes» annexées par l’empire austro-hongrois et réclamées par l’Italie comme terre irredente. Il n’en sera pas question ici, le cas de la Corse, objet de notre propos, comme celui de Malte, souvent traité en parallèle, se rapportant aux terres qui n’ont jamais fait partie institutionnellement de l’Italie mais qui ont suscité des revendications, une fois celle-ci constituée en Etat-nation. Le sujet n’est pas nouveau et il a déjà fait l’objet, plus ou moins directement, de dizaines d’articles ou d’ouvrages. Cette bibliographie, déjà ancienne, a même connu ces dernières années un regain d’intérêt dont témoignent diverses études tant d’historiens français qu’italiens. Encore convient-il de faire un tri ou, du moins, de se méfier d’études trop «orientées» ou mal cernées, dont celles qui ne font pas toujours la distinction entre autonomisme et irrédentisme ; nous y reviendrons en fin d’exposé afin de lever cette ambigüité gênante, source d’incompréhension, voire de polémique encore de nos jours. Irrédentisme, autonomisme, collaborationnisme, sont des concepts qui se recoupent et il est bon de les considérer séparément dans un premier temps, avant de s’intéresser à leur imbrication.
LES PREMICES DU MOUVEMENT
Jusqu’à quand peut-on faire remonter la revendication irrédentiste ? Dans la mesure où nous avons défini ce courant comme émanant de l’Italie en tant qu’ État constitué en nation contestant à d’autres États la possession de terres italiennes, on ne saurait parler d’irrédentisme antérieurement à 1860, date de la réalisation de l’unité italienne. A ce titre on a pu dire que Milan et le Milanais reconquis sur l’Autriche étaient les premières terres «irredente», précédant d’une dizaine d’années la «récupération» de Venise et de la Vénétie, elles aussi terre irredente. Pourtant, si on se place du point de vue des prémices du mouvement, on peut remonter à l’époque du triennio révolutionnaire et, plus précisément à l’année 1796 où se tint à Milan, dans le cadre de la république cisalpine et à l’initiative de Bonaparte, général en chef de l’armée d’Italie, une consulte réunissant les giacobini les plus en vue appelés à faire des propositions sur ce que pourrait être institutionnellement une Italie politiquement unifiée. Or, il y fut déjà question de la Corse considérée par plusieurs des intervenants comme devant être partie prenante au projet. L’ombre tutélaire de Bonaparte adepte – avec un certain retard il est vrai – d’une Corse faisant «partie intégrante de l’Empire français», conformément au décret du 30 novembre 1789, mit un terme à cette élucubration. Il n’en sera plus question par la suite et la Corse ne fera pas partie du royaume d’Italie créé en 1805.
De la chute de l’empire napoléonien à la création de l’unité italienne, au temps du Risorgimento, entre 1815 et 1860, période qui a donné lieu à de nombreux travaux que nous ne rappellerons pas ici, la plupart des meneurs du mouvement tendant à l’unité italienne, de Mazzini à Garibaldi en passant par Gioberti, Buonarroti Guerrazzi et bien d’autres, ainsi que les fuorusciti qui, comme Tommaseo, séjournèrent sur l’île en tant qu’exilés, ont fait allusion à la Corse et tous, clairement ou à mots couverts, ont fait le constat qu’il était anormal que cette île soit française. Pourtant, à aucun moment il n’a été envisagé de passer aux actes et de la faire basculer de la France à l’Italie. Il fut bien question au lendemain de la révolution de juillet de la part de patriotes italiens d’un échange entre Corse et Savoie, mais cela n’est pas allé très loin, les conjurés «sans Etat» n’étant pas en mesure de mener à bien une telle négociation et la prudence les invitant à la plus grande réserve. On prête à l’un d’eux, Claudio Linari, d’avoir mis en garde ses compagnons en ces termes «Ah ! Si Sebastiani savait, il nous mangerait tout crus », ce qui ne va pas sans rappeler l’attitude de Bonaparte en 1796 face aux giacobini. Reste que la question corse n’a jamais été une préoccupation majeure des unitaires qui, sous Napoléon III, remballèrent toute velléité «récupératrice» de la Corse, compte tenu du rôle de la France dans la réalisation de l’unité italienne, au moins jusqu’à l’affaire des Etats du pape. Le paradoxe de la période est de voir le nouvel empereur faire preuve d’irrédentisme à rebours à l’égard de la jeune nation, en obtenant le rattachement à la France du comté de Nice et de la Savoie !
Vu du coté corse, l’italianité, la fidélité à la langue vernaculaire, la célébration des mœurs traditionnelles, disons de manière générale la culture populaire au sens gramscien du terme, marquent cette période également connotée d’une forme de romantisme dont l’Italie n’eut pas alors l’apanage. Mais, exceptionnellement, ce revival culturel est présenté comme un défi à l’appartenance française de l’île : «Je me sens italien plus que français» a pu déclarer Salvatore Viale, chef de file du cercle de lettrés portant son nom, qui réunissait des italianisants cultivés, conscients d’une déculturation qu’ils déploraient mais contre laquelle ils ne se dressèrent pas ouvertement sur le plan politique. Le regard porté par Salvatore Viale, membre de l’honorable bourgeoisie bastiaise et bien intégré dans le petit monde de la magistrature insulaire, a pu être critique à l’égard du changement mais sans que cela fasse de lui un carbonaro voué pour son pays à la cause de l’unité italienne. Il en va de même d’autres familles insulaires telles que les Semidei au temps des monarchies constitutionnelles, engagées politiquement aux côtés des libéraux italiens contre la domination étrangère en Italie, mais sans que ce rejet de l’occupant «étranger» (l’Autriche en l’occurrence) ne remette en question leur appartenance nationale. En revanche, on peut presque déjà parler d’irrédentisme lorsqu’il s’agit de Corses entièrement voués à la cause de l’unité italienne comme Leonetto Cipriani et d’autres, systématiquement «découverts» et donnés dans l’Arcbivio Storico di Corsica comme preuve d’une volonté de retour à la mère-patrie. Mais qu’en est-il de ces «volontaires» d’origine corse qui, aux côtés des patriotes italiens, prirent part à des expéditions ou à des affrontements armés pour chasser l’Autrichien de la péninsule déjà en 1831-32 puis, lors des révolutions de 1848 ? Faut-il voir en eux des patriotes ou de simples mercenaires dont l’action s’inscrit dans une longue tradition? Il est difficile de faire la part des choses, mais nous ne suivrons pas les yeux fermés, à propos des carbonari puis des pinnuti, l’historiographie italienne qui les célèbre comme des héros de l’unité italienne. Evoquons ici le dialogue entre le célèbre fuorscito Tommaseo et le Corse Arrigo Arrighi ou les réactions d’un G.P. Borghetti, poète italianisant, ancien de l’expédition des Mille, pinnutu en Tavagna à ses heures et représentatif de ce qu’on peut appeler l’internationale libérale de l’époque : sans détour, celui-ci répond à son interlocuteur qu’un Corse peut se sentir culturellement italien, mais il n’est pas concevable que la Corse fille de la Révolution… et de Napoléon, cesse d’être française.
ITALIA FATTA
Nous nous rapprochons plus du sujet en considérant la période post-unitaire autour des années 1880, les premières années de la nouvelle république italienne étant essentiellement consacrées aux problèmes intérieurs. Bientôt on voit apparaître dans les manuels scolaires d’histoire et de géographie l’image d’une Corse qui gémit sous le joug étranger et le thème est repris à l’association pour l’Italia irredente née en 1878. Les données changent vraiment sous les gouvernements de Francesco Crispi entre1881 et 1896. Celui-ci, qui avait combattu dans les rangs des patriotes libéraux voués à la cause unitaire, allait devenir une fois au pouvoir le chantre d’une Italie impérialiste faisant valoir des intérêts nationaux et affirmant dès visées extérieures comme pour ne pas être en reste par rapport aux grandes puissances qui se lançaient alors, non sans succès, dans l’aventure coloniale. Après avoir hésité et gardé de bons rapports avec la France et l’Angleterre, l’Italie adhère à la Triple Alliance en 1881 et renouvelle ce pacte en 1888. Les relations entre la France et l’Italie se dégradent un peu plus depuis la signature du traité de Bardo qui consacre la tutelle française sur la Tunisie, au point que l’on craint un conflit ouvert dont on s’inquiète localement. Le journaliste du Temps, Ardouin Dumazet, alors en Corse pour enquêter sur le pays, signale les fortifications qui sont construites le long de la côte ajaccienne pour repousser l’éventuel envahisseur et on oublie trop souvent que la statue de Sampiero Corso à Bastelica avec notre héros brandissant son épée en direction de la péninsule, est une œuvre dissuasive à l’adresse de ceux qui auraient des visées de conquête sur la Corse. C’est une des premières fois où les Corses, notamment les républicains comme les députés Alexandre Bartoli et Dominique François Ceccaldi réagissent contre le danger irrédentiste. La presse se fait l’écho de cette inquiétude et on peut lire dans l’Indépendant du 14 janvier 1883 : «les Corses se souviennent de Sampiero et de Paoli, des longues luttes que leurs pères ont soutenues pour l’indépendance de leur île et les Italiens devront s’apercevoir qu’ils ne sont pour nous que des étrangers». Camille Pelletan s’en émeut également à la Chambre en enfonçant le clou.
Affectée par ses échecs coloniaux, l’Italie s’enferre dans un mal-être nationaliste qui caractérise les deux dernières décennies qui précèdent la Grande Guerre. Certes les regards sont encore principalement tournés vers les terres irredente du Trentin, du haut Adige et de la côte dalmate mais, dès lors, la Corse et l’île de Malte entrent dans le collimateur et sont l’objet de propos et de considérations explicites qui ne débouchent pas toutefois sur des actes d’hostilité ouverte. Les tenants de ce nationalisme italien qui fait alors une percée remarquable sur l’échiquier politique sont le sénateur Ernesto Corradini, fondateur du journal l’Idea Nazionale et de l’Association Nationaliste italienne, Federzoni qui sera un temps président de la même assemblée puis ministre des Colonies rallié au fascisme ou encore Josué Carducci, poète et homme de lettres, Futur prix Nobel de littérature. Ces têtes pensantes du mouvement n’hésitent plus à réclamer le retour de la Corse dans le giron de l’Italie suivant une argumentation qui prélude à la thématique irrédentiste développée durant l’entre-deux-guerres. Citons la contribution d’Oreste Tencajoli au journal l’Idea nazionale : il rappelle que la Corse est terre italienne et qu’elle devrait faire partie du jeune Etat né en 1870.
L’ IRREDENTISME DURANT L’ENTRE-DEUX-GUERRES

La frustration et même la rancœur éprouvées par l’Italie au lendemain de la guerre et du traité de Versailles où à elle a été traitée comme une puissance de second plan, ne fut pas étrangère, la crise économique aidant, à l’émergence d’un irrédentisme d’action et non plus seulement de pensée ou de paroles. L’épisode de l’opération «coup de poing» conduite par d’Annunzio à Fiume, ouvertement dirigée contre l’occupant autrichien, en est le signe le plus patent, Le charismatique aventurier qui se posait en libérateur de cette terre irredente fit alors figure de héros aux yeux de l’opinion publique, plus particulièrement de la droite nationaliste que nous avons évoquée et dont des membres influents se retrouveront daim le proche entourage de Mussolini. Le fascisme, en tant que courant politique qui s’imposera dans les années qui suivent, prend le relais et ne tarde pas à théoriser sur l’opportunité d’une conquête ou d’une reconquête des terre irredente, Corse comprise, comme par défi, dans un premier temps du moins, lancé à la France accusée de ne pas avoir soutenu les revendications italiennes lors des négociations de Versailles. On peut dater de 1923-1924 cet élargissement du champ de la revendication irrédentiste portée par l’Etat mussolinien, non sans une certaine prudence dictée par des impératifs diplomatiques.
En 1924, une structure financée par l’Etat est instituée sur ordre de Mussolini sous le nom de Comitato secreto per la Corsica ayant pour objectif, comme on peut le lire dans un rapport rétrospectif du ministère de l’Intérieur, d’entretenir un lien vivace entre les Italiens de la péninsule et les Corses de l’île. Les membres de l’influente famille Ciano dont le père Costanzo (l’amiral) figure de proue du mouvement nationaliste et son fils, Galeazzo, futur ministre des Affaires étrangères et gendre de Mussolini, en faisaient partie. Mais le véritable animateur de cette commission informelle et tenue secrète fut le fameux Francesco Guerri, simple enseignant-directeur de l’école secondaire de Livourne, qui allait consacrer l’essentiel de son activité militante à la «libération» de la Corse du «joug français». Ce personnage que nous retrouvons à chaque étape ou manifestation importante de la revendication irrédentiste, avait son «quartier général» à Livourne, lieu focal des manifestations du mouvement, qu’il s’agisse de cérémonies publiques, de productions éditoriales, d’actions de propagande à l’adresse des Corses, de l’accueil des boursiers insulaires et des relations avec les groupements fascistes dont celui des étudiants corses de l’université de Pise. Guerri nous est aussi connu par son activité journalistique et éditoriale, par ses propres écrits ou ouvrages dont le fameux Viaggio d’un vagabonde qui est comme bible de l’irrédentisme concernant la Corse. Il fut l’agent du mouvement le plus en relation avec les insulaires autonomistes du parti de Petru Rocca. Avec lui nous découvrons, à la lumière des archives italiennes qui ont permis de lever le doute sur la question, le financement de la Muvra. Une coquette somme d’argent était ainsi réservée au comité de Livourne afin d’encourager le mouvement autonomiste en Corse. C’est à Livourne également qu’eurent lieu au cours de la période les seules manifestations publiques de l’irrédentisme avec, en 1930, la cérémonie du drapeau corse présenté à un organisme d’anciens combattants et, en 1936, l’inauguration de la lampe votive dédiée à la mémoire de Pascal Paoli en l’église Santa Croce de Florence. Dans les deux cas, l’Etat assura le financement de ces manifestations organisées par Francesco Guerri et par le corse irrédentiste Marco Angeli.
Plus important du point de vue des initiatives étatiques est le recours à ceux que l’on peut qualifier de missionnaires plus ou moins directement mandatés par le gouvernement et qui furent amenés à séjourner en Corse «à la découverte» du pays. Nous retrouvons ici Oreste Tencajoli, le premier «inventeur» des églises romanes de Corse, le professeur de lettres Biscottini, l’historien Ersilio Michel «installé» par Gioacchino Volpe, l’archéologue Giglioli et d’autres qui ont laissé les traces de leur(s) séjour(s) en Corse et qui ont livré le fruit de leurs savants travaux. Ces missions officieuses, prises en charge partiellement au moins par le gouvernement de Mussolini, allaient au-delà de simples manifestations d’enquête sur l’état de l’opinion. Le fait que les personnages les plus en vue de ces initiatives aient été des universitaires ou des lettrés n’est pas anodin : leur mission en Corse même et, à leur retour, en Italie, était de recueillir et de mettre en forme scientifiquement les données tendant à fournir les preuves de l’italianité de l’île. C’est là en l’occurrence un exemple de la mobilisation des intellectuels qu’affectionnait le régime. En dehors de ceux qui n’eurent pas directement la pratique du terrain mais qui gravitaient dans l’entourage du pouvoir, faisons une place à part à Gioacchino Volpe, fondateur de l’Archivio siorto di Corsica et, en quelque sorte, théoricien du mouvement. Ajoutons-y Gino Bottiglioni, auteur et coordinateur du monumental Ailante Linguistico di Corsica. Il y eut aussi, répondant aux mêmes objectifs les revues éditées sur le continent ou en Sardaigne comme Tyrrhenio et Mediterranea. Avec le temps, la production éditoriale de contenu irrédentiste devint plus abondante et l’Etat accrut sa participation en liaison avec la maison d’édition Giusti de Livourne, pour faire face à ce besoin croissant et soulager les presses d’Erasme Santi qui publiait des ouvrages irrédentistes et Bastia Journal, feuille locale financée par l’Italie, tout comme d’autres journaux «de droite» qui faisaient l’éloge de Mussolini et du fascisme. Nous ne nous étendrons pas sur la thématique de l’italianité de la Corse largement traitée par ailleurs et ici même par d’autres intervenants.
L’engagement de l’Etat fut par ailleurs éclairant dans sa politique de ralliement de jeunes Corses auxquels étaient proposées des bourses d’études pour se rendre dans les universités ou dans des cours secondaires du continent, principalement en Toscane, avec un attrait particulier pour l’université de Pise. Cette politique des boursiers ne concerna pas un nombre important d’insulaires, une vingtaine tout au plus a-t-on pu dire, parmi lesquels figurent de fortes personnalités comme Giovacchini, Filippini, Marco Angeli ou encore Gianmari, acteurs convaincus de la cause irrédentiste. Militants à l’origine au Partitu Corsu d’Azione, ils franchirent par la suite le pas de la rupture avec la France. Certains d’entre eux, moins en vue, répondirent à l’appel des sirènes irrédentistes parce qu’ils en espéraient des jours meilleurs par la suite en bénéficiant des faveurs italiennes. Par ailleurs, en Corse même, le gouvernement et plus précisément le ministère des Affaires étrangères en charge de l’opération, comptait sur le maillage étroit du réseau consulaire italien qui enserrait l’île. Les consuls, agents et vice consuls établis à Bastia et Ajaccio et en d’autres points de Corse devaient régulièrement rendre compte de leurs activités au service de leurs ressortissants (une dizaine de milliers d’individus, travailleurs saisonniers pour la plupart, mais aussi une minorité d’entre eux qui s’étaient établis en Corse, y fondant une famille tant en milieu rural qu’à la ville. Il s’agissait de bien les encadrer et, dans les séances du Dopo lavoro, de les soumettre à la propagande afin de faire d’eux de bons fascistes dévoués au régime et au Duce. Mais on comptait aussi sur eux pour rendre l’Italie attrayante auprès des Corses et favoriser ainsi la cause de l’irrédentisme. Ce fut là un échec patent car les Italiens de Corse, en général d’origine modeste et peu politisés, se dérobaient à ces avances, boudaient le Dopo lavoro et n’étaient pas portés à faire le prosélytisme qu’on attendait d’eux dans un contexte international incertain, par crainte de représailles des insulaires auprès desquels ils n’avaient pas bonne presse.
QUEL ECHO EN CORSE DE LA PRESSE IRREDENTISTE ?
De fait, le bilan de l’action de l’Etat mussolinien est marqué par un fiasco complet face à une opposition qui, tout au long de la période, et bien avant le fameux serment de Bastia de 1938, marqua son hostilité à la perspective d’une Corse italienne. Ce rejet fut régulièrement exprimé par la vox populi dont se faisaient l’écho les rapports de police et les articles ou éditoriaux de la presse d’obédience radicale, animée notamment par les journalistes Bianconi et Livelli, véritables «lanceurs d’alerte» face au péril irrédentiste. Parmi les journaux les plus sensibilisés figure le Petit Bastiais qui ne manquait pas de tenir au courant le service des renseignements généraux et l’administration préfectorale qui eut recours aux expulsions ou aux interdictions de paraître, s’agissant de publications jugées subversives telles que le Telegrafo ou Corsica antica e rnoderna. La conscience du danger fut moins évidente dans la presse «de droite» telle que Bastia Journal frappé du sceau du collaborationnisme. Imprudence ou complicité, le débat reste ouvert. On sait que La Nouvelle Corse était favorable à l’union latine et qu’elle approuva le rapprochement diplomatique franco-italien des années 34-35 qui virent également Horace de Carbuccia, l’homme de Gringoire, rendre visite au Duce à Rome sans qu’il soit fait allusion à la menace irrédentiste. Cette différence entre les journalistes radicaux d’un côté et la droite fascisante représentée par Erasme Santi ou Nicola de Susini est illustrée par l’affaire de l’expulsion d’Oreste Tencajoli qui suscita une vive polémique entre ceux qui, à droite, jugèrent que cette mesure était injustifiée alors qu’à gauche on s’en félicitait,
Sur un autre registre qui ne regarde que quelques irrédentistes insulaires dont des membres du clergé tels que l’abbé Carlotti auxquels il faudrait ajouter des séculiers ou des réguliers qui venaient du continent en mission ou pour prêcher le carême, apparaît en filigrane la complaisance des religieux de Corse qui, par hostilité a la République, aggravée par la récente séparation de l’Eglise et de l’Etat, ont contribué à faire naître ou entretenir un sentiment d’indifférence ou d’hostilité à l’égard de la patrie française. L’exemple nous est donné par Bertino Poli, grâce au témoignage de sa nièce Gisèle Poli. Pour expliquer le parcours anti-français de cet irrédentiste impénitent, celle-ci déclare ou laisse entendre qu’il a été imprégné durant son enfance et son adolescence de langue et de littérature italienne, celle de Dante et de l’Arioste, et marqué par une culture religieuse traditionnelle qui passait par l’usage de l’italien ou du latin plus que du français au catéchisme, en dehors même de l’école. L’exemple est ici localisé dans le Fiumorbo, à Poggio di Nazza, mais c’est surtout dans le Vicolais et dans la région de Cervione que l’on peut mieux faire ce constat. Dans le premier cas, la veine irrédentiste illustrée par des Leca nous ramène au temps de Santu Casanova et de son hostilité à l’égard de Marianne, entretenue par les religieux de cet ancien siège épiscopal doté d’un couvent où les frères mineurs dispensaient un enseignement italianisant. Dans le second cas, au pays de Filippini, de Gianmari, de Giovachini et des Marchetti, nous avons aussi affaire à un petit monde réticent à l’égard de la francisation où, comme dans le Vicolais, les religieux du couvent franciscain et des séculiers gravitant autour du siège de l’ancien évêché n’ont pas manqué d’entretenir une constante italophilie.
AVANT LA GUERRE L’IRREDENTISME À DECOUVERT
L’étude de l’irrédentisme stricto sensu, comme nous avons convenu de le faire, a été en grande partie renouvelée par l’historiographie italienne ; alors que le phénomène avait longtemps été considéré comme un tout, une périodisation a mis en lumière des hauts et des bas, au gré des fluctuations diplomatiques et des distorsions internes. L’analyse des moyens mis à la disposition des acteurs de cette politique est trompeuse si on en déduit que l’on a affaire à une action concertée et déterminée qui se développe uniformément depuis l’avènement de Mussolini jusqu’à sa chute. En replaçant la question dans les relations internationales de la période, on perçoit que les faiblesses de l’Etat italien face aux démocraties occidentales invitaient à la prudence, d’autant que toute velléité belliqueuse aurait pu également déplaire à l’Allemagne qui n’entendait pas que son allié prenne des initiatives qui auraient pu contrarier sa propre diplomatie longtemps rassurante aux yeux de la France et de l’Angleterre. Cette pusillanimité appliquée à la question corse prévaut jusqu’aux lendemains de 1936. Jusque-là, les mesures qui entretiennent l’irrédentisme relèvent du secret d’Etat et n’ont pas de quoi agiter la chemise rouge. Les incartades, qui sont le fait de zélés partisans de la cause, ont souvent été réfrénées par Mussolini lui-même, comme en témoigne le cas de Gioacchino Volpe à qui le Duce demanda, avant la parution de l’Archivio Storico di Corsica, de suspendre la publication d’une revue dont le contenu risquait d’alarmer le Quai d’Orsay. Volpe se montra d’ailleurs plus prudent et plus habile par la suite. Francesco Guerri fut également rappelé à l’ordre et ses initiatives en matière de manifestations publiques de caractère irrédentiste ne furent pas toujours bien vues par les autorités soucieuses de ne pas provoquer d’incident diplomatique. Une modération du même ordre caractérise Galeazzo Ciano, actif et volontariste dans le cadre du comité corse de Livourne, mais plus discret et timoré à la table des négociations lorsqu’il s’agissait de la Corse.
A partir de 1936, la question de l’irrédentisme à l’égard de la Corse ne va plus se poser dans les mêmes termes, en raison de l’évolution des relations internationales et des rapports entre la France et l’Italie. Du côté italien, le changement est lié à l’affaire d’Ethiopie, cette nouvelle aventure coloniale qui eut plus de succès que celle tentée contre Mehemet Ali au temps de Crispi. La prise d’Addis Abeba qui consacra l’achèvement de la conquête fut vécue comme une revanche par rapport à la cuisante défaite d’Adoua de 1896. Mussolini conforté en la circonstance par l’attitude bienveillante d’Hitler bombe le torse et s’oppose avec virulence à la politique des sanctions réclamée par les démocraties occidentales ; c’est alors la remise en question de l’union latine scellée à Stresa en 1935 et bientôt l’émergence du rêve d’hégémonie méditerranéenne prenant l’ Empire romain comme modèle ; Mussolini, plus hardi qu’autrefois, considère dès lors la Corse comme un verrou de pénétration menaçante dans la mer Tyrrhénienne et il ne se cache plus pour le dire. Pour d’autres raisons, l’entente entre les deux puissances est mise à mal. L’avènement du Front populaire en France ne peut qu’indisposer idéologiquement l’Italie fasciste et ce virage à gauche a des répercussions lors de la guerre d’Espagne où les deux Etats se retrouvent dans des camps opposés. Même à droite, sur l’échiquier politique français, on commence à s’inquiéter et à craindre des visées italiennes sur la Corse et les réactions françaises ne tardent pas à se manifester, la droite et et gauche faisant front commun devant le danger. En témoigne l’inauguration de la statue de Napoléon au Casone à Ajaccio en 1938, où la présence des autorités et d’élus de tout bord est perçue comme une réponse à la fois symbolique et déterminée face à la menace italienne. Le député radical César Campinchi, ministre de la Marine, qui s’était déjà montré intransigeant lors de «la politique des sanctions» contre l’Italie, monte régulièrement au créneau et multiplie des interventions publiques anti-italiennes au cours de l’année 1938 dont certaines en présence de marins corses harangués sur leurs navires, ce qui ne va pas sans provoquer des incidents diplomatiques. Du côté italien, l’acmé de la provocation se situe le 30 novembre 1938 à la Chambre des faisceaux où le discours de Ciano est salué par les cris en chœur des députés sur le thème de Corsica nostra, au même titre que d’autres terre irredente. Passons sur divers incidents en Corse même où est régulièrement impliqué le consulat d’Italie, l’acmé de la tension, du côté insulaire, se situant le 4 décembre à Bastia où est prononcé et acclamé le fameux serment d’une Corse qui veut et qui doit reste française.
PENDANT LA GUERRE
L’historiographie italienne, à la lecture d’archives nouvelles, a également renouvelé la question de l’irrédentisme durant la guerre où, paradoxalement par rapport à la tension croissante dont nous avons fait état et à la position de force que l’Italie croyait tenir de son alliance avec l’Allemagne, victorieuse en 1940, on aurait pu penser que son désir de conquête de l’île serait satisfait. Il n’en fut pourtant pas ainsi et, tout au long de la période, au-delà même du débarquement en novembre 1942 de 80.000 soldats italiens et de leur installation en Corse dès lors occupée, tant que Mussolini fut au pouvoir, avant son élimination en juillet 1943, la Corse ne fut pas annexée par son menaçant voisin. Dès le lendemain de l’armistice qui mit un terme à «la drôle de guerre» puis à la piteuse tentative de l’Italie une fois de plus de jouer un rôle dans la cour des Grands et d’apporter sa contribution à la victoire de l’Axe sur le front alpin, il fut décidé que la Corse, se trouvant au sud de la ligne de démarcation, subirait le même sort que la France de la zone libre, situation bancale où le pays continuerait à être administré par un préfet tenu de respecter les clauses de la commission d’armistice qui siégeait à Turin et non pas à Rome.
Dans ce contexte, la revendication irrédentiste, en porte-à-faux par rapport aux décisions prises, retombe quelque peu, Est-ce à dire que, bridée par son puissant allié peu désireux de la voir s’émanciper et mener sa propre politique, l’Italie ait renoncé à «faire valoir ses droits» sur la Corse ? Non point car la revendication persista sous ses formes habituelles passant par la voie écrite, celle des publications tendant à prouver l’italianité de l’île sur le ton de l’isola perdez ou Corsica nostra. On n’a pas suffisamment remarqué que les productions des polémistes les plus engagés de l’entre-deux-guerres, comme on les désigne le plus souvent de façon globale, datent en fait de cette période de la guerre où ils ont continué à jouir de l’aide morale et matérielle de l’Etat bien que celui-ci ait eu une position de retrait. Mussolini, loin d’avoir renié ces va-t-en guerre tels que Biscottini, Bottiglioni ou Giglioli, les a encouragés, tout en les cantonnant dans leur domaine de propagandistes «non officiels» et sans suivre leurs injonctions lorsque ces derniers, à la fois déterminés et impatients, pensaient que le moment était venu de passer aux actes. Le pouvoir, redevenu rapidement plus prudent en raison de la situation internationale et de la tutelle de l’Allemagne est pour sa part demeuré inactif et n’a pas cédé aux pressions des militaires les plus haut placés tels que Badoglio, prêts à en découdre et à annexer la Corse, certains allant jusqu’à suggérer la forme que pourrait prendre cette annexion sur un plan institutionnel à la lumière de ce qui était tenté par ailleurs, notamment dans les Balkans : qui pensait à une annexion pure et simple, qui envisageait un régime particulier sous l’autorité d’un vice-roi, d’un haut-commissaire ou d’un gouverneur, formule traditionnelle d’un pays récemment conquis, comme la Corse, en d’autres temps, en avait fait l’expérience.
C’est le moment de revenir sur le rôle des quelques irrédentistes d’origine corse qui ont renié la France pour se donner corps et âme à l’Italie fasciste, militant pour un retour de l’île à la «mère patrie» ? Ce sont eux qui sont les plus impatients, les plus «envahissants même, peut-on dire, auprès du Duce, afin que celui-ci passe à l’action. A leur tête, incontestablement, Pietro Giovacchini, originaire de Canale di Verde, qui a déjà fait beaucoup parler de lui avant la guerre pour avoir fondé les gruppi di cultura corsa à Pavie et les avoir animés au cours des années 30. Il contribue durant la guerre à les transformer en gruppi d’azione corsa, plus revendicatifs que leurs prédécesseurs et il se flatte de compter plusieurs milliers d’adhérents. Cela lui donne une certaine audience et lui permet d’être reçu et encouragé par le Duce en personne. A ce titre il jouera un rôle actif dans les expositions organisées à Rome et à Venise sur le thème de l’italianité de la Corse. Giovacchini s’était déjà taillé une réputation auprès des fascistes en participant comme combattant volontaire à la campagne d’Ethiopie puis à la guerre d’Espagne. Il se fait encore remarquer en 1942 en venant haranguer sur place en Forêt Noire des prisonniers français d’origine corse, leur offrant la liberté à condition qu’ils se fassent naturaliser italiens et qu’ils servent le régime, proposition à laquelle les intéressés répondirent en entonnant la Marseillaise. Giovacchini ne fut pas suivi par le pouvoir mais il n’a pas eu non plus à se plaindre en montant en grade dans l’appareil d’Etat. Anton’ Francesco Filippini a rivalisé avec lui de ce point de vue. Animateur d’une radio déjà fondée à Turin en 1939, il émet en direct à destination de la Corse des émissions de propagande plus régulières, bénéficiant de l’aide de l’Etat. Il avait ses entrées au ministère de la Culture populaire et il percevait une coquette pension pour ses activités où on relève la direction qu’il assurait d’un groupement d’industriels fascistes. Il n’en resta pas moins poète et journaliste, fondateur du journal l’Idea nazionale. Moins adulé par le pouvoir et en ressentant une certaine rancœur, Marco Angeli ne faiblit pas dans ses convictions mais demeura plus dans l’ombre tandis que Francesco Gianmari continua à exercer ses talents de graveur xylographe au service de la cause, secondé par son épouse, une violoniste italienne. Quant à Bertino Poli, plus convaincu que jamais, il livra sous la forme «bilan et perspective» un ouvrage de synthèse qui fait date dans le mouvement.
AUTONOMISME ET IRREDENTISME
L’amalgame entre les deux courants qui a été fait dès l’époque et qui est encore bien ancré dans des esprits contemporains, a fait l’objet d’un traitement qui n’a pas pleinement convaincu ceux qui sont portés à les considérer comme un tout et en particulier à taxer d’irrédentistes les membres du PCA (le Partitu Corsa d’Azione), les Muvristes, Petru Rocca lui-même et ses compagnons de route. On prendra acte aisément du fait que militer pour l’autonomisme sous ses différents aspects, linguistique, culturel et institutionnel, ne veut pas dire que l’on veuille que la Corse devienne politiquement italienne et il est facile de faire litière de ce jugement erroné.
Pourtant, un certain nombre de remarques s’imposent si nous ne voulons pas céder à un irénisme trompeur qui ne tendrait qu’à dédouaner l’autonomisme en le dépouillant de ses connotations sulfureuses. S’en tenir à une analyse purement factuelle se voulant historiquement objective, sans prendre en compte l’imaginaire, le «ressenti» et les connotations du phénomène, c’est faire une histoire «à thèse» dépouillée de ce qui peut être gênant à propos de ce que l’on veut montrer. Non, les Muvristes n’étaient pas des irrédentistes, à l’exception d’une poignée d’entre eux qui le sont devenus. Oui, ils ont milité pour leur propre cause en protestant contre la façon dont ils pensaient avoir été et être encore traités par la France, s’insurgeant contre le fait que l’usage de l’idiome corse, en tant que langue régionale, ait été brimé par le recours systématique au français, et déplorant que l’histoire de la Corse soit bannie de l’enseignement primaire et secondaire, etc. Mais on ne saurait évacuer le fait que l’essentiel de leurs plaintes et protestations contre la France se retrouvent à l’identique dans les textes irrédentistes. Les deux courants rivalisent ainsi pour condamner la « maltraitance » française. La Muvra et le Telegrafo mènent le même combat pour discréditer la France et leurs articles sont interchangeables. Les auteurs, prosateurs, poètes, historiens, folkloristes des deux tendances ont collaboré, sans que cela soit explicite, à l’éclectique revue Corsica antica e moderna où on retrouve les doléances habituelles portant sur l’absence de mesures de caractère économique en faveur de la Corse, carence rendue responsable d’une émigration de masse sur le continent ou dans l’empire colonial, ce qui a rendu le pays exsangue ; les plaintes partagées portent encore sur les méfaits de la déculturation des Corses menacés, comme on dirait aujourd’hui, de perdre une identité, inséparable de l’italianité. Observons au passage que la plupart de ces doléances s’étalaient déjà dans la Tramuntana, ancêtre de la Muvra, sous la plume de Santu Casanova, père de l’autonomisme insulaire, lequel finit ses jours en 1936 en Italie en irrédentiste convaincu après avoir rendu un hommage dithyrambique au Duce. Il y a là de quoi évidemment se poser des questions sur «la voie de passage», comme ses contemporains déjà n’ont pas manqué de le faire On peut comprendre aisément l’amalgame qui a pu se faire dans les esprits et dans les rapports de police dont les auteurs étaient portés, par déformation professionnelle, par négligence, ou par excès de zèle, à ne pas faire la distinction. Nous sommes là encore sur un registre qui était déjà celui de la Tramuntana. On peut encore relever que, du point de vue des manifestations publiques, l’érection de la croix de Ponte Novo ou la célébration du souvenir de l’embarquement de Paoli et de son père Hyacinthe à partir de Padulella, trouvent leurs pendants dans la cérémonie du drapeau organisée en 1930 à Livourne par Marco Angeli et celle de la lampe votive en l’honneur de la mémoire de Pascal Paoli à l’église Santa Croce de Florence en 1936. D’autres signes vont dans le même sens. Ainsi, le financement de la Muvra, les bonnes relations ouvertement entretenues entre autonomistes et irrédentistes, par exemple entre Petru Rocca et l’inévitable Francesco Guerri ou entre Yvia Croce et Oreste Tencajoli. Sur le terrain des relations internationales, par idéologie ou par haine de la France, les deux se rejoignent souvent. Le gouvernement fasciste de Mussolini, trouve grâce aux yeux des Muvristes pour sa politique expansionniste à l’extérieur et son intervention en Lybie. Cet alignement sur les puissances de l’Axe à l’approche de la guerre vaudra d’ailleurs quelques déboires à Petru Rocca, condamné pour la première fois en 1940 pour atteinte à la sûreté de l’État .
L’amalgame entre autonomisme et irrédentisme devient plus prégnant au lendemain immédiat de la guerre avec le procès dit des irrédentistes dans le cadre de la politique d’épuration visant les collaborateurs. On enregistre alors quelques condamnations, la plupart par contumace, pour ce qu’il en est des plus en vue d’entre eux comme Pietro Giovacchini ou Marco Angeli qui réaliseront leur souhait de mourir, comme ils avaient vécu, en terre italienne, leur véritable patrie. Quant à Anton Francescu Filippini, frappé par la même condamnation, il était déjà lui aussi à Rome au moment de sa condamnation et il continuera, à y vivre paisiblement, sans jamais revoir sa Corse natale. L’ambigüité subsiste pourtant car, dans le même procès, on s’est prononcé sur le sort de collaborateurs certes, mais aussi sur des autonomistes ou des «innocents» qui ont fait partie de la même fournée alors qu’ils n’avaient rien à voir avec ceux qui avaient été sensibles à l’appel irrédentiste. Aujourd’hui encore une certaine historiographie italienne tend à célébrer comme héros et martyrs, les irrédentistes d’origine corse jugés et condamnés en 1946 afin de réhabiliter un courant considéré comme patriotique. Mais l’initiative de Giulio Vignoli, historien contemporain principalement concerné, ne porte que sur la petite minorité sur laquelle nous nous sommes arrêtés. Un bon accueil, voire une conversion à l’irrédentisme n’ont pas fait boule de neige en Corse où, dans les rangs même de ceux qui avaient cédé au chant des sirènes, beaucoup en sont revenu. C’est le cas de Jules Colombani de Lugo di Nazza qui a pu même faire figure de «repenti», mais dont le nom fut mêlé à une polémique déclenchée par un «grand reportage» journalistique relativement récent.
Quant à l’irrédentisme en tant que revendication de l’Etat italien qui a essentiellement été l’objet de cette introduction, il n’en fut plus guère question depuis la fin de la guerre. Avec le temps, la construction européenne, une mobilité accrue, une fréquentation plus intense entre les deux pays, l’extension du tourisme et la croissance des échanges économiques, ont fait que le contentieux entre France et Italie s’est progressivement effacé et cette normalisation des relations concerne directement la Corse. En revanche, dans la mémoire collective, l’amalgame entre autonomisme et irrédentisme a laissé des traces et fait encore polémique. D’un côté, d’aucuns considèrent, surtout dans les rangs des néo-autonomistes pour qui la France n’est qu’un «pays ami», qu’il est temps de tourner la page et de réhabiliter Petru Rocca et ses comparses. Des noms de rue, d’associations ou de cercles de réflexion, des interviews ou des court-métrages télévisés contribuent à lever l’opprobre qui pèse sur eux et invitent à prendre en considération le courant autonomistes d’avant la guerre, n’accordant pas outre mesure d’attention aux ambiguïtés signalées. Inversement il y a ceux «qui n’oublient pas», mus par un véritable culte de la Résistance et qui se méfient de mises au point à la fois partielles et partiales, tendant à gommer les compromissions des «traîtres» avec «l’ennemi». Il conviendrait, pour notre part, que l’historien qui tend à comprendre les faits les replace dans leur contexte, faisant une place à la représentation du phénomène dans la mémoire collective et dépassant une approche tronquée qui se veut strictement positiviste. C’est là élargir le champ historique d’une question qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.