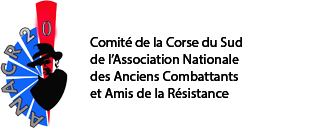82 ans plus tard, une cérémonie rassemblait quelques dizaines de personnes devant la statue de Fred Scamaroni dans l’avenue éponyme d’Ajaccio. En présence du préfet, Mr Jérôme Filippini, du maire d’Ajaccio, Mr Stéphane Sbraggia, des autorités civiles et militaires, Antoine Poletti, pour l’ ANACR 2A, a rendu hommage à ce pur héros de la résistance insulaire.
« Il faut s’imaginer ce que fut le chaos de la défaite de 1940 ; des millions de gens fuyant les zones de combat, jetés sur les routes, un naufrage. S’imaginer la stupeur, l’angoisse, un gouffre d’incertitude qui saisit alors les Français ; l’Apocalypse. « Il est vain de résister prêche la radio d’État. Il faut faire le dos rond et rester tous unis derrière le maréchal Pétain, lui obéir ». Et majoritairement les Français vont accepter un temps, avant que les yeux se dessillent, ce narcotique et calamiteux armistice que le gouvernement de Vichy administre aux Français.
« Confronté à un tel affaissement moral de la nation, à commencer par ses élites, la conscience de Scamaroni lui commande au contraire de désobéir parce que « Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir » disait ce slogan des plus lucides. Scamaroni en était. Pétri de certitudes patriotiques et républicaines – Son père, était préfet, et lui-même se destinait à cette carrière préfectorale – Fred Scamaroni fait le choix de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Quelques jours auparavant, fin mai 1940, il a déjà subi l’épreuve du feu. Il en était revenu blessé, décoré de la Croix de Guerre et il n’entend pas maintenant rendre les armes.
« Il arrive dans la capitale anglaise dès le 23 juin, cinq jours seulement après l’appel lancé par le général de Gaulle ; une remarquable précocité de son engagement au service des Forces Françaises Libres – ils ne sont que 7 000 seulement fin juillet. Deux mois plus tard, il fait partie du raid anglo-français sur Dakar pour tenter de rallier les territoires de l’Afrique Équatoriale Française. Un échec.
« Il est fait prisonnier et ramené en France, malade, après un périple qui l’a mené du Sénégal jusqu’à Alger en passant par le Mali. Il est libéré en février 1941 mais révoqué du corps préfectoral il occupe un poste subalterne au secrétariat d’État au ravitaillement ; en fait, lui est ainsi offerte l’opportunité pour se déplacer avec un motif officiel. Il se rend en Corse en avril 1941 où il prend des contacts en vue de créer un réseau de résistance. Parmi ceux-ci le sénateur Paul Giacobbi qui avec quatre-vingts autres parlementaires a refusé les pleins pouvoirs à Pétain. A Vichy même, avec quelques amis, Fred Scamaroni crée le réseau Copernic. Repéré par la Gestapo, la France libre lui demande de rejoindre Londres. Il y arrive en janvier 1942.
« Il est affecté à l’état-major du général de Gaulle et versé au Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA). Il rejoint l’Algérie où les Alliés ont pris pied à la mi-novembre. Avec le concours des services secrets anglais, l’OSS, il organise une mission en Corse, son île natale occupée par les troupes italiennes. La mission Sea Urchin – c’est son nom – débarque clandestinement trois hommes dans la nuit du 6 au 7 janvier 1943 à Cupabia, une plage de Serra di Ferro. Objectif : créer un réseau gaulliste, R2 Corse.
« Deux mois plus tard, Fred Scamaroni, alias François-Edmond Severi, est arrêté et le réseau tombe ; les uns en fuite, les autres, 17, sont arrêtés. A l’origine de cette arrestation, il y a une négligence des services secrets alliés à Alger qui ont fait se rencontrer le radio de la mission, Héllier, et un traitre malencontreusement recruté lui aussi, pour une mission concomitante en Sardaigne. Héllier, reconnu par le traitre dans un bar d’Ajaccio, est arrêté le 18 mars. Après avoir résisté à la torture plus de vingt heures durant, Héllier finit par « craquer ». Scamaroni est arrêté à son tour le 19 mars. Il est horriblement torturé.
« Au tortionnaire qui lui promet la vie sauve s’il parle, il rétorque : « Vous ne savez pas ce qu’est l’honneur ! ». Fred Scamaroni ne parle pas. Ce premier jour d’interrogatoire et de torture il n’a pas parlé mais est-il sûr de ne jamais céder ? Alors dans le doute il choisit de se suicider. Les gardiens découvrent son corps inanimé dans la cellule de la citadelle au petit matin. Une mort héroïque dans le droit fil d’un engagement patriotique inébranlable pour la grande et la petite partie, la France et la Corse confondues.
« Plus de huit décennies après, en rendant hommage à Fred Scamaroni, nous continuons d’entretenir le souvenir de nos héros et martyrs. Soit ! Mais la question se pose de savoir si le monde d’aujourd’hui est à la hauteur des sacrifices et des espoirs de nos martyrs. Assurément, NON ! Les inégalités, l’oppression, le fanatisme religieux, les conflits ethniques, la faim, les guerres sévissent partout dans le monde n’épargnant pas les populations civiles. Ces fléaux contraignent, chaque année des millions d’hommes, de femmes et d’enfants à fuir la terre où ils vivaient pour essayer de trouver refuge ailleurs, parfois loin de leur pays. Et se pose aujourd’hui, avec toujours plus d’acuité, l’usage immodéré que l’homme fait des ressources de la planète alors que celle-ci est déjà bien abîmée. L’homme va vers l’avenir les yeux bandés.
Bafoués les droits de l’homme, ceux des femmes plus encore.
Piétinées les promesses de paix et le respect des peuples dans leurs frontières.
Transgressés les grands principes universalistes qui ont inspiré la Charte des Nations-Unies.
Pas un continent sur la carte de la mappemonde où ne hérissent des régimes autoritaires, voire des dictatures agressives pour qui «le droit de la force prime la force du droit». Le mal est profond. Ce grand désordre du monde fait douter de la démocratie dans des pays qui en sont le berceau et devraient en être les défenseurs. En leur sein même, percent les relents de cette idéologie qui a mis le monde à feu et à sang. On peut à raison s’interroger sur l’ambigüité de ces bras tendus comme pour un salut fasciste sur une affiche de campagne électorale en Allemagne ou lors d’un rassemblement politique aux États-Unis ; s’inquiéter en Corse des discours visant à la réhabilitation d’irrédentistes collaborateurs notoires.
« Le temps de l’Apocalypse n’est plus, constatait Albert Camus après-guerre. Nous sommes entrés dans celui de la médiocre organisation et des accommodements sans grandeur. Par sagesse et par goût pour le bonheur, il faut préférer celui-ci, bien qu’on sache qu’à force de médiocrité, on revienne aux apocalypses. » Et « la menace peut renaître plus redoutable que jamais » précisait le général de Gaulle.
Un avertissement.